Du Made In au Made With
Si le Made in France rassure, il ne suffit plus.
Les consommateurs ne veulent plus savoir où c’est produit, mais ce que ça produit autour d’eux. Place au “Made With” : un nouveau contrat entre marques et territoires, fondé sur la cocréation, la preuve et l’impact local. Une lecture critique et inspirante du rôle des marques dans la fabrique du lien territorial.
Les limites du “Made in”
Labels : des consommateurs en perte de confiance
Le “Made in France” devait être un repère de confiance, il est devenu une zone grise. En 2020, 87 % des Français se déclaraient séduits par l’origine française d’un produit. En 2024, ils ne sont plus que 73% à y voir un gage de fiabilité (Caisse des Dépôts, 2024). La promesse s’érode, usée par un “French-washing” qui multiplie les pseudo-labels et jouent sur la confusion des termes, souvent sans preuve d’engagement réel.
Résultat : la confiance s’effrite. 35% des consommateurs doutent désormais que les produits estampillés “Made in France” soient réellement fabriqués sur le territoire (OpinionWay pour CCI France, 2023). Le phénomène traduit une fatigue de la preuve : trop de labels, trop de mentions, trop de complexité. Entre les certifications officielles (Origine France Garantie, label “Fabriqué en France”, Origin’Info…) ou les auto-déclarations (transformé, cuisiné, conçu, assemblé… en France), chaque logo raconte sa propre vérité. L’authenticité devient un labyrinthe, entretenant la défiance chez les consommateurs. Résultat : aujourd’hui, seulement un tiers des consommateurs utilise les labels comme point de repère pour décider d’acheter un produit alimentaire (étude Kantar de 2022). Il est sans doute temps d’un “choc de simplification”.

Du national au local
La question est politique autant qu’économique : à qui servent vraiment les labels ?
Aux producteurs locaux ? Aux consommateurs ? Ou aux marques qui capitalisent sur une tendance ? Selon l’étude Opinion Way pour la CCI, une majorité des Français achètent du “Made in France” en priorité pour soutenir les producteurs locaux, plutôt que pour soutenir l’économie nationale. Acheter local, c’est contribuer à une économie de proximité, à une dynamique circulaire, à une échelle humaine identifiable. Cette préférence traduit une attente de sens et de besoin de repères tangibles : les consommateurs veulent des preuves d’utilité concrètes, pas juste des slogans.
Qui raconte le territoire aujourd’hui ?
Dans les années 1980, l’État incarnait la promesse de protection économique et sociale. Ce temps est révolu, l’État a perdu le monopole de la confiance (étude France 2040, Fondation Jean-Jaurès). Les Français ne croient plus aux grands récits industriels de souveraineté : ils investissent leur confiance dans des échelles tangibles : la région, la ville, le bassin de vie. Le territoire devient l’unité de mesure de l’engagement. On ne croit plus à “la France qui produit”, mais à “mon territoire qui agit”. Ce glissement consacre le passage du “Made in France” au “Made in près de chez moi…”.
Après la désindustrialisation, les Français ont vu leurs repères se dissoudre : l’usine a quitté le paysage mental, remplacé par les marques qui ont pris sa place comme nouveaux producteurs d’imaginaires territoriaux. Et ce nouveau rôle pose question : qui raconte le territoire aujourd’hui ? Une marque, un élu, un collectif ?
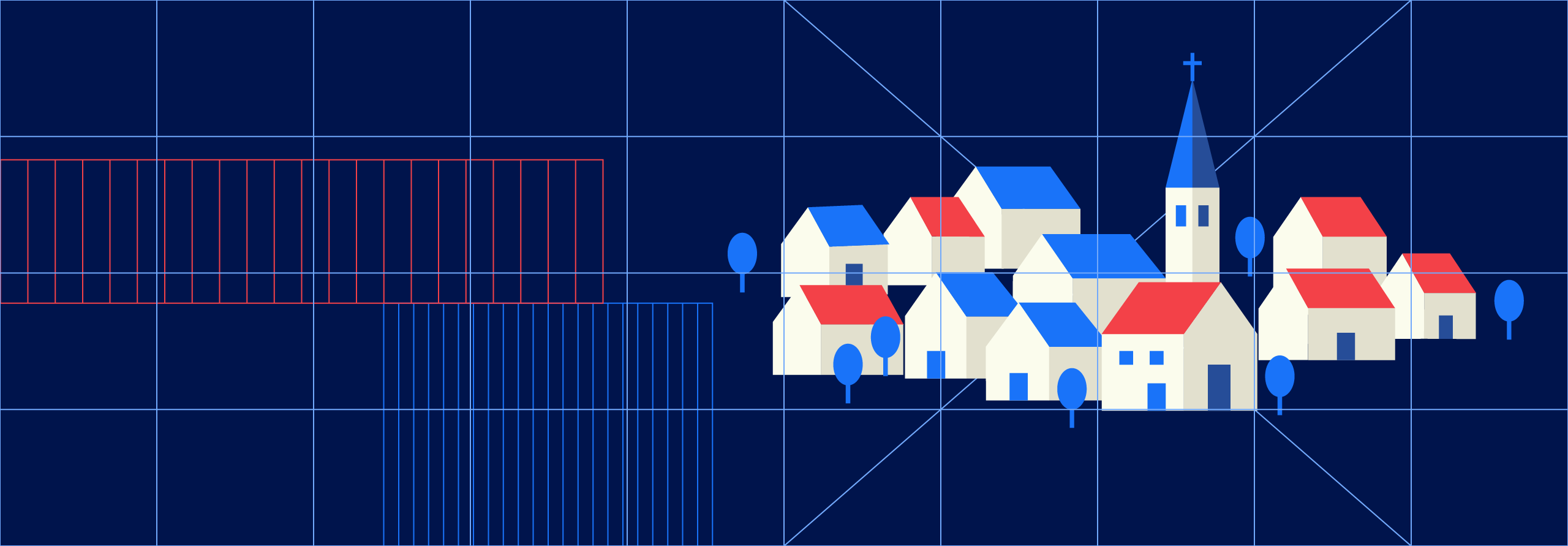
La fabrique d’un territoire fantasmé : le « petit village sépia »
Trente ans d’images rassurantes… et standardisées
Pendant des années, en réponse à une mondialisation et une perte de repères, les marques, la grande distribution en première ligne, ont saturé l’imaginaire collectif de campagnes idéalisées : clochers, collines dorées, typographies rustiques, recettes “d’antan”. Ce “kit terroir” a fait le job : rassurer en rapprochant symboliquement les consommateurs d’une France apaisée (on a tous en tête les packagings de Saint-Môret et coté MDD, Reflets de France ou encore Nos Régions ont du Talent). Mais il a aussi nivelé la richesse et la diversité des territoires.
Résultat : un langage visuel standardisé que l’on pourrait coller indifféremment sur un beurre breton ou une terrine provençale. Ces univers “sépia” figent une ruralité hors sol et fantasmée, or, la France et les modes de vie se sont recomposés en “archipels”. Continuer à raconter la France rurale à travers une iconographie figée, c’est “muséifier le pays et ignorer les transformations sociales et économiques à l’œuvre” (Raphaël Llorca, L’imaginaire territorial des marques, Institut Terram & Fondation Jean Jaurès).

Le territoire n’est pas un décor
Notre “souveraineté narrative” serait-elle confisquée par les marques et quelques acteurs privés ? En s’appropriant des symboles, des récits et des figures propres à certains lieux à travers la publicité, le packaging ou les réseaux sociaux, la représentation des territoires devient une arme de soft power. Avec le risque de simplifier, voire de déformer et de caricaturer. Cette confiscation est renforcée par les plateformes, et les réseaux sociaux sont devenus eux aussi de grands producteurs de clichés des territoires français. Leurs représentations, calibrées pour l’attention instantanée, finissent souvent par réduire la France à une série de cartes postales mondialisées : un Paris d’opéra et de macarons (Emily in Paris), une Provence saturée de lavande (Dream Links, un soap opéra chinois), un littoral instagrammable en éternel coucher de soleil.
Ces visions séduisent, mais elles déforment en réduisant un pays à quelques clichés figés, sans nuance, ni complexité. Alors disons-le : le territoire n’est pas un décor, c’est un tissu vivant fait de réalités économiques, sociales et environnementales multiples et contrastées ! On ne peut plus “peindre” les territoires, il faut composer avec eux. Passer du décor au contrat. Du Made IN au Made WITH.
Réinventer le lien entre les marques et les territoires :
du « Made In » au « Made With »
Du territoire comme décor au territoire comme partenaire
Aujourd’hui, le territoire est un partenaire. Il n’est plus une ressource à exploiter, mais un écosystème vivant avec lequel les marques et les entreprises entretiennent des relations d’interdépendances. Ces relations se mesurent, se documentent, se nourrissent… et surtout elles se racontent. Cette bascule répond à une demande : les consommateurs veulent des preuves d’impact, les élus attendent des retombées concrètes, les collaborateurs recherchent du sens localisé.
La “Responsabilité Territoriale des Marques”
La RSE, longtemps cantonnée à une logique de reporting descendante et souvent déconnectée du terrain, montre ses limites. C’est désormais à la Responsabilité Territoriale des Entreprises (RTE), que revient la mission de valoriser l’impact local d’une activité et d’entretenir des synergies avec les acteurs de son écosystème. Pour le marketing, cet exercice ouvre un champ narratif très riche. Son rôle : traduire les interactions économiques et humaines en récits singuliers, authentiques et créateurs de préférence. Comment mettre les mots et les images sur les interactions entre les hommes, les lieux et les ressources ?
Voici quelques exemples de marques qui incarnent bien cette approche de la RTE et du « Made With » :
BabyBio, la Marque enracinée
Propriétaire de ses propres fermes en Val de Loire, Babybio cultive ses fruits et légumes en agroforesterie, une approche où arbres, sols et cultures cohabitent pour restaurer la biodiversité. Cette maîtrise de la filière – de la graine au pot – donne une cohérence rare dans l’univers de l’agroalimentaire : le bio n’est plus un label, c’est une pratique quotidienne.
Mais la force de Babybio tient aussi à sa manière de raconter ce lien. Avec un récit qui se déploie sur trois plans. Économique : une marque à taille humaine, enracinée dans son écosystème productif. Écologique : une filière circulaire et régénérative. Émotionnel : une promesse simple, “nourrir les bébés en nourrissant les territoires”. Avec sa signature “Acteur engagé du bio & local” Babybio fait de son ancrage territorial une chaîne de confiance entre le vivant, les parents et les enfants. Pixelis a accompagné cette démarche avec un design packaging qui met en scène la sincérité du local sans folklore : un univers visuel sobre et vivant, à l’image d’une marque qui revendique moins son origine que son impact tangible.
Cas Pixelis

Les 2 Gourmands, la Marque communauté locale
Les 2 Gourmands, c’est une marque de biscuits sucrés et salés avec des ingrédients sourcés localement… mais c’est d’abord la rencontre de deux entrepreneurs, Guillaume et Louis, franciliens convaincus qu’il est encore possible de réconcilier le goût, le bon sens et la proximité. Leur intuition : remettre le lien social au centre de notre alimentation. Très vite, cette idée prend corps autour d’un lieu : la Ferme de Crespières, dans les Yvelines. Une ferme à taille humaine, ouverte sur son territoire, où se croisent producteurs, artisans, consommateurs et familles. Ce lieu devient l’ancrage vivant de la marque, mêlant espace de production, de rencontre et de pédagogie. Ici, le local n’est pas un argument de vente, c’est un cadre de vie.
“La liberté de nous exprimer par une action directe et sans intermédiaire”. C’est ainsi que les fondateurs résument leur démarche : agir à la source avec une exigence de traçabilité, de convivialité et l’envie de rassembler tous les gourmands. Les 2 Gourmands s’affirment comme une marque-communauté. Une communauté de producteurs, qui défendent une agriculture de proximité et une rémunération juste. Une communauté de consommateurs, qui viennent, visiter, déguster, échanger, comprendre. Une communauté de territoire, où chaque acteur devient ambassadeur d’un même écosystème.
L’enjeu pour la marque n’est pas seulement de fabriquer des biscuits ou des confitures, mais de fabriquer du lien. La ferme devient un point de convergence des valeurs, un lieu qui incarne la sincérité et la cohérence du projet : production locale, transformation artisanale, accueil du public, transmission des savoir-faire.
Pixelis accompagne aujourd’hui la nouvelle étape du projet : la refonte complète de l’identité de marque, de son positionnement à son univers visuel (lancement prévu début 2026). L’objectif : traduire cette vision d’un “local vécu”, une marque qui parle moins de terroir que de communauté ancrée, moins de tradition que de gourmandise partagée.

Coca-Cola, la Marque “glocale”
Coca-Cola, c’est l’archétype de la marque universelle, reconnaissable, planétaire. Mais derrière cette icône se cache une réalité beaucoup plus locale, souvent méconnue : 99 % des boissons Coca-Cola vendues en France sont produites en France, dans huit sites de production répartis sur le territoire. Un fait simple mais puissant, et un levier de crédibilité et de réconciliation entre un imaginaire global et une empreinte territoriale réelle. La campagne “Produit Par”, lancée en 2024, part de cet insight : « Derrière chaque boisson, il y a une personne. Une histoire. Une fierté. » (Fanny Happiette, Directrice Marketing France, Coca-Cola France)
Cette phrase illustre un versant narratif de la marque. Coca-Cola ne parle ni de fraîcheur ni d’hédonisme universel, mais des gens qui produisent : 4 collaborateurs de Coca-Cola venus d’horizons et de sites différents (usine, logistique, distribution, R&D) ont été mis en lumière à travers une campagne de portraits qui donne un visage humain à la production et ancre la marque dans ses territoires. Une communication de proximité et un discours de marque-employeur qui valorise la diversité, le savoir-faire industriel et la fierté d’appartenance. Coca-Cola parvient ainsi à transformer une statistique industrielle en récit émotionnel collectif.

Alpes françaises 2030, la marque d’un écosystème
Les Jeux Olympiques d’Hiver 2030 marqueront un tournant : le passage d’une ville-hôte à un écosystème-hôte. Pour la première fois, la candidature française abandonne la logique classique d’un nom de ville (Chamonix 1924, Grenoble 1968, Albertville 1992) pour embrasser une vision géographique, écologique et systémique du territoire.
Le nom “Alpes Françaises 2030” incarne ce basculement symbolique. Il déplace le regard : de l’échelle urbaine vers l’échelle bio-géographique, du bâti vers le vivant, du lieu unique vers un territoire interconnecté. Ce choix n’est pas seulement sémantique, il est politique. Il traduit la prise de conscience que le territoire n’est pas un décor pour accueillir des événements sportifs, mais un système vivant composé de bassins versants, de sols, de biodiversité, d’infrastructures et d’habitants. Nommer les Jeux “Alpes Françaises 2030”, c’est parler d’une entité géographique en mutation, soumise au dérèglement climatique, à la raréfaction des ressources et à la nécessaire réinvention d’un modèle économique.
La future identité de cette candidature devra, de fait, s’inscrire dans une rupture culturelle : d’une approche anthropocentrée à une approche écosystémique (le territoire comme co-acteur du projet). Comment représenter un territoire qui n’est plus un point sur la carte, mais un tissu vivant de flux et de relations ? “Alpes Françaises 2030” ne sera pas la marque d’un lieu, mais celle d’une relation au lieu. Une marque de transition, qui fait du vivant le nouveau cadre de référence, et du territoire une communauté d’équilibres à préserver.
En cela, ce projet préfigure le futur du Made With : une marque qui ne revendique plus l’exploitation d’un territoire, mais qui se pense comme partenaire du vivant.

Les 3 repères clés pour raconter son «Made With»
1. Faire du territoire un modèle d’affaires, pas un argument
Le “Made With” commence par le business model : les marques qui réussissent à incarner un ancrage territorial ne se contentent pas d’y apposer une étiquette : elles transforment leurs pratiques et leurs chaînes de valeur. Le territoire devient un partenaire de création, un laboratoire d’innovation et un acteur de la performance.
→ Enjeu Branding : le territoire n’est plus seulement une origine, il devient une méthode. Les marques les plus crédibles sont celles qui traduisent leur ancrage en système de preuves économiques : emplois, circuits courts, investissements mesurables. C’est ce qu’on pourrait appeler la “Design Proof” du territoire, la matérialisation du sens dans le modèle économique.
2. Passer du « discours de marque » au « récit de transformation »
Un territoire n’existe que s’il est raconté, mais il ne devient crédible que s’il est vécu. La communication territoriale de demain doit rendre visibles les dynamiques, les savoir-faire, les coopérations, les initiatives locales, le tout incarné par les gens qui font.
Le rôle de la marque est alors double : documenter les interactions entre son activité et le territoire (ses flux, ses impacts, ses interdépendances) ; inspirer en montrant comment ces interactions produisent de la valeur collective.
→ Enjeu Branding : passer d’une logique de preuve de conformité à une logique de preuve de transformation. Le “Made With” ne s’affirme pas, il se démontre par récits pluriels, coconstruits avec les acteurs du territoire, comme on le ferait d’un reportage plutôt que d’une publicité.
3. Faire du collectif un levier d’incarnation
Le “Made With” ne repose pas uniquement sur les partenariats économiques ou les récits partagés : il s’évalue à la capacité d’une marque à mobiliser et animer une communauté vivante, collaborateurs, fournisseurs, habitants, associations, élus, consommateurs. Le territoire devient un espace d’interaction et non un simple contexte.
→ Enjeu Branding : la marque devient un agent relationnel, un catalyseur d’alliances locales. Elle mesure son succès à la qualité des coopérations qu’elle suscite : synergies, alliances, cocréations. Le “Made With” est un branding relationnel, où la valeur se construit dans l’interdépendance et la co-responsabilité.
Reprendre la main sur les récits territoriaux
Les marques françaises ont longtemps vu dans le “Made in France” une garantie morale et un réflexe marketing. Mais à l’heure où les consommateurs challengent la provenance, la transparence et les impacts, le territoire devient un contrat qui engage. Il oblige à une nouvelle Responsabilité Territoriale des Marques :
→ une responsabilité de preuve (mesurer et rendre compte),
→ une responsabilité de représentation (ne pas caricaturer, mais révéler),
→ une responsabilité de transmission (raconter les liens, pas les légendes).
Et pour distinguer demain les marques et les entreprises qui contribuent réellement à la vitalité de leurs territoires, celles qui font du local un levier de transformation, il faut de nouveaux indicateurs et de nouvelles scènes de reconnaissance.
À ce titre Pixelis, accompagné de Lakaa, a créé en 2024 le Prix de l’Impact Local des Entreprises. Un prix qui récompense les marques et entreprises qui créent de la valeur territoriale mesurable et partagée. Concrètement, l’année dernière nous avons récompensé l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est [ART GE], qui, avec son Centre de Ressources du Tourisme Durable et son outil EcoBoussole, accompagne les acteurs du tourisme dans la région Grand Est vers des pratiques plus responsables au service du territoire. Ou encore, le prix a récompensé la marque Les 2 Vaches / Les Près Rient Bio, pour tout leur engagement sur la production Bio et la juste rémunération sur le territoire normand. Ce prix incarne bien la nécessité de mettre en avant la RTE et le “Made With” au travers de projets concrets et incarnés.